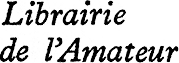Vendu
éd. 1835
LAVATER (Johann Kaspar)
L'art de connaitre les hommes par la physionomie. Nouvelle édition corrigée et disposée dans un ordre plus méthodique, augmentée d'une exposition des recherches ou des opinions de La Chambre, de Porta, de Camper, de Gall, sur la physionomie ; d'une histoire anatomique et physiologique de la face ; précédée d'une notice historique sur l'auteur, par Moreau (de la Sarthe). Ornée de 600 gravures en taille-douce, dont 82 tirées en couleurs et exécutées sous l'inspection de Vincent, peintre.
Paris, Depelasol, 1835 ; 10 volumes grand in-8, 3 ff.n.ch. + 419 + 236 + 292 + 316 + 320 + 260 + 278 + 288 + 315 + 269 pp., demi-chagrin aubergine à coins de l'époque, dos lisses ornés d'un joli décor romantique, tomaisons frappées en pieds, papier flammé sur les plats de couleurs violette, rouge et crème, tranches marbrées (minimes traces de frottement aux dos des tomes 9 & 10). Les 10 volumes.
Inscrivez-vous pour recevoir des lettres d’information concernant notre librairie.